ANNÉES DE RÊVES ET DE PLOMB DES GREVES A LA LUTTE ARMEE
[Luttes Italie 1970’s] Extraits du livre d’Alessandro Stella (Agone 2016)
Lire Extraits
ANNÉES DE REVES ET DE PLOMB – DES GREVES A LA LUTTE ARMÉE EN ITALIE (1968-1980)
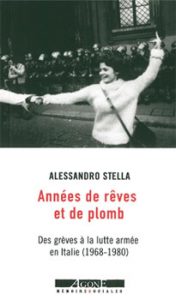 Extrait (p.20): « Les funérailles des camarades morts furent préparées rapidement par les familles: celles d’Antonietta et d’Angelo l’après midi du vendredi 13, celles d’Alberto le samedi 14 avril. Nous étions le vendredi et le samedi de Pâques, la religion imposait de ne pas célébrer de messes, et le silence des cérémonies funéraires était perturbé par le vrombissement des hélicoptères des carabiniers qui tournaient nerveusement dans le ciel ainsi que le croassement des radio-transmetteurs de la police, qui avait mis toute la région en état de siège. Les camarades qui convergeaient vers Thiene de toute la Vénétie devaient passer à travers deux ou trois barrages des forces de l’ordre; qu’ils arrivent en voiture, en train ou en car, tous étaient méthodiquement interpellés, fouillés, fichés. Outre les policiers, les carabiniers et les forces anti-émeutes, arrivèrent aussi sur place les hommes de la section anti-terroriste des carabiniers du général Carlo Alberto Dalla Chiesa. Il fallait bien du courage et de la détermination pour traverser les barrages militaires, mais quelques centaines de personnes réussirent à rallier les cimetières de Thiene et Chiuppano, pour rendre hommage et porter un dernier salut aux camarades morts. »
Extrait (p.20): « Les funérailles des camarades morts furent préparées rapidement par les familles: celles d’Antonietta et d’Angelo l’après midi du vendredi 13, celles d’Alberto le samedi 14 avril. Nous étions le vendredi et le samedi de Pâques, la religion imposait de ne pas célébrer de messes, et le silence des cérémonies funéraires était perturbé par le vrombissement des hélicoptères des carabiniers qui tournaient nerveusement dans le ciel ainsi que le croassement des radio-transmetteurs de la police, qui avait mis toute la région en état de siège. Les camarades qui convergeaient vers Thiene de toute la Vénétie devaient passer à travers deux ou trois barrages des forces de l’ordre; qu’ils arrivent en voiture, en train ou en car, tous étaient méthodiquement interpellés, fouillés, fichés. Outre les policiers, les carabiniers et les forces anti-émeutes, arrivèrent aussi sur place les hommes de la section anti-terroriste des carabiniers du général Carlo Alberto Dalla Chiesa. Il fallait bien du courage et de la détermination pour traverser les barrages militaires, mais quelques centaines de personnes réussirent à rallier les cimetières de Thiene et Chiuppano, pour rendre hommage et porter un dernier salut aux camarades morts. »
Extrait (p.34): « L’année suivante en 1980, les arrestations et les mandats d’arrêt décimèrent les rangs des camarades de Padoue et Rovigo; l’année suivante ce fut le tour des Vénitiens. On nous avait criminalisés, marginalisés, emprisonnés; mais au delà de nos personnes, c’est tout le mouvement de contestation social qui se trouvait réduit au silence. Les faits les plus emblématiques avaient été le licenciement, au mois d’octobre 1979, de 61 ouvriers de chez Fiat « soupçonnés de sympathies subversives », suivi un an plus tard par la manifestation de 40000 « cols blancs » de la marque automobile de Turin en défense de la politique patronale. On pressentait la fin d’un cycle. La phase ascendante de ce mouvement était terminée, commençaient alors les années sombres: pour certains des années de prisons, pour d’autres la voie de la clandestinité en Italie ou de l’exil à l’étranger, pour ceux rester libre la tâche ingrate d’assister les prisonniers, de maintenir en vie quelques structures légales comme les radios et les coopératives, d’organiser des concerts pour récolter quatre sous, et de tenter désespérément de trouver de nouvelle sympathie à la cause. »
Extrait (p.65): « J’ai grandi dans une famille, une grande famille italienne, dans laquelle la faim était certes devenue un souvenir, mais où il y avait la conscience chaque jour réitérée de la fatigue et de la sueur que coûtait le pain sur la table. Un pain qu’il fallait partager. Mes parents votaient démocrate-chrétien et considéraient les communistes comme d’affreux athées, mais combien de fois les ai-je entendus s’indigner contre tant d’injustices à travers le monde, contre les torts faits aux faibles, contre le sort fait aux pauvres! Ils liaient leur esprit humaniste et fraternel aux enseignements des évangiles chrétiens et, pour mon père, le marxisme était une version laïque aberrante du christianisme. (…) L’affection et la solidarité de ma famille, de mon père en particulier, ont eu une importance fondamentale dans mon existence, aussi et surtout pendant les années difficiles, où ils ne m’ont pas laissé tomber. Certes, ils n’étaient pas du tout d’accord avec mes choix radicaux, mais pas non plus avec la criminalisation de leur rejeton. Interviewé par une télévision régionale après l’émission du mandat d’arrêt contre moi, mon père arriva à dire que bien qu’il fût opposé aux méthodes violentes adoptées par son fils, il en comprenait les motivations. »
Extrait (p.84): « A part l’autodéfense dans les manifs et les affrontements avec les fascistes, nos premières actions illégales dans le Vicentin furent des appels aux armes, avec des pochoirs apposés nuitamment sur les murs de Schio et de Valdagno vantant la lutte armée et les Brigades rouges. Car outre la culture libertaire, le courant communiste révolutionnaire et le message guévariste, était né en Italie au début des années 70 un modèle national auquel on pouvait s’identifier: les Brigades rouges. Ils avaient dix ans de plus que nous et avaient connu directement 1968; pendant que nous regardions passer les défilés des ouvriers, ils marchaient avec eux. Leurs premières actions exemplaires, comme la mise au pilori du directeur du personnel de Siemens ou de Magneti Marelli, avaient fasciné bien des jeunes aspirants révolutionnaires. »
Extrait (p.107): « Du nord au sud de l’Italie jusqu’aux iles s’étaient formée une constellation de groupes sociaux, de comités d’ouvriers, de collectifs d’étudiants et de coordinations de toute sorte qui faisaient référence à la mouvance de l’Autonomie. Les désormais « vieux » groupes extra-parlementaires issus de 1968 s’étaient dissous ou institutionnalisés et, dans la rue comme sur les places, c’était à l’Autonomie que s’identifiait la génération rebelle de 1977. De nouveaux fanzines et des revues militantes étaient nés, d’analyse mais aussi satiriques, underground, néo-surréalistes. Les radios libres de la mouvance autonome étaient désormais installées, écoutées, suivies, et des librairies, des imprimeries, des coopératives, des petites infrastructures de toute sorte soutenaient le mouvement. (…) Comme toujours dans l’histoire, l’explosion d’une révolte est imprévisible, fruit de multiples facteurs. Mais cela se respirait dans l’air, on sentait une montée de fièvre de rébellion. (…) On entendait aussi que l’appel aux armes, à l’illégalité de masse, avait pénétré avec son tam-tam dans les usines, les quartiers populaires, les universités et jusqu’aux lycées. De février à mars 1977, les occupations, les manifestations, les affrontements avec les forces de l’ordre s’étaient succédé, de plus en plus tendus, dans toutes les principales villes italiennes. Ce que tant d’analystes n’arrivaient pas à classifier, que certains définissaient comme « un étrange mouvement d’étranges étudiants », était effectivement un mouvement multiforme, dans lequel convergeait des composantes diverses: des marxistes-léninistes aux situationnistes, des fêtards aux soldats de la révolution, des étudiants aux précaires, des chômeurs aux jeunes ouvriers. Dans les manifs se côtoyaient des « Indiens métropolitains » qui se roulaient des pétards et chantaient des slogans ironiques, des féministes qui revendiquaient de nouveaux droits pour les femmes en dansant, des jeunes prolétaires des banlieues qui en profitaient pour « faire des courses », et des rangs de gens masqués et militarisés qui acclamaient la lutte armée avec trois doigts en forme de pistolet pointés vers le ciel. »
Extrait (p.135): « J’avais fui l’Italie, je cherchais un pays où vivre librement, sans l’angoisse permanente d’être arrêté et de finir en prison. Et, à 25 ans, je m’étais retrouvé au Mexique, un pays immense, grand comme plusieurs fois l’Italie, où j’étais passé du sentiment d’être recherché et clandestin à celui d’être anonyme. Que faire ? La question ne concernait plus la stratégie politique à suivre, mais simplement des conduites quotidiennes pour manger et se loger, comme n’importe qui. Continuer dans l’illégalité me semblait une folie suicidaire. Continuer dans la guérilla, faire la révolution mondiale était le rêve de Che Guevara, et il en était mort. Le fait est que la guérilla, la résistance armée, la guerre tout court mettent les gens dans un état physique et psychologique qu’elles ne peuvent pas se prolonger à l’infini, et les guerres se terminent souvent quand les combattants n’arrivent plus à se battre et à regarder le sang couler, et ne rêvent plus que de paix, d’une vie normale. Pour paradoxal que cela puisse paraître, après des années de clandestinité, à être tout le temps sur les dents, certains camarades éprouvaient une sensation de soulagement au moment de leur arrestation, libérés en quelque sorte de l’angoisse permanente.